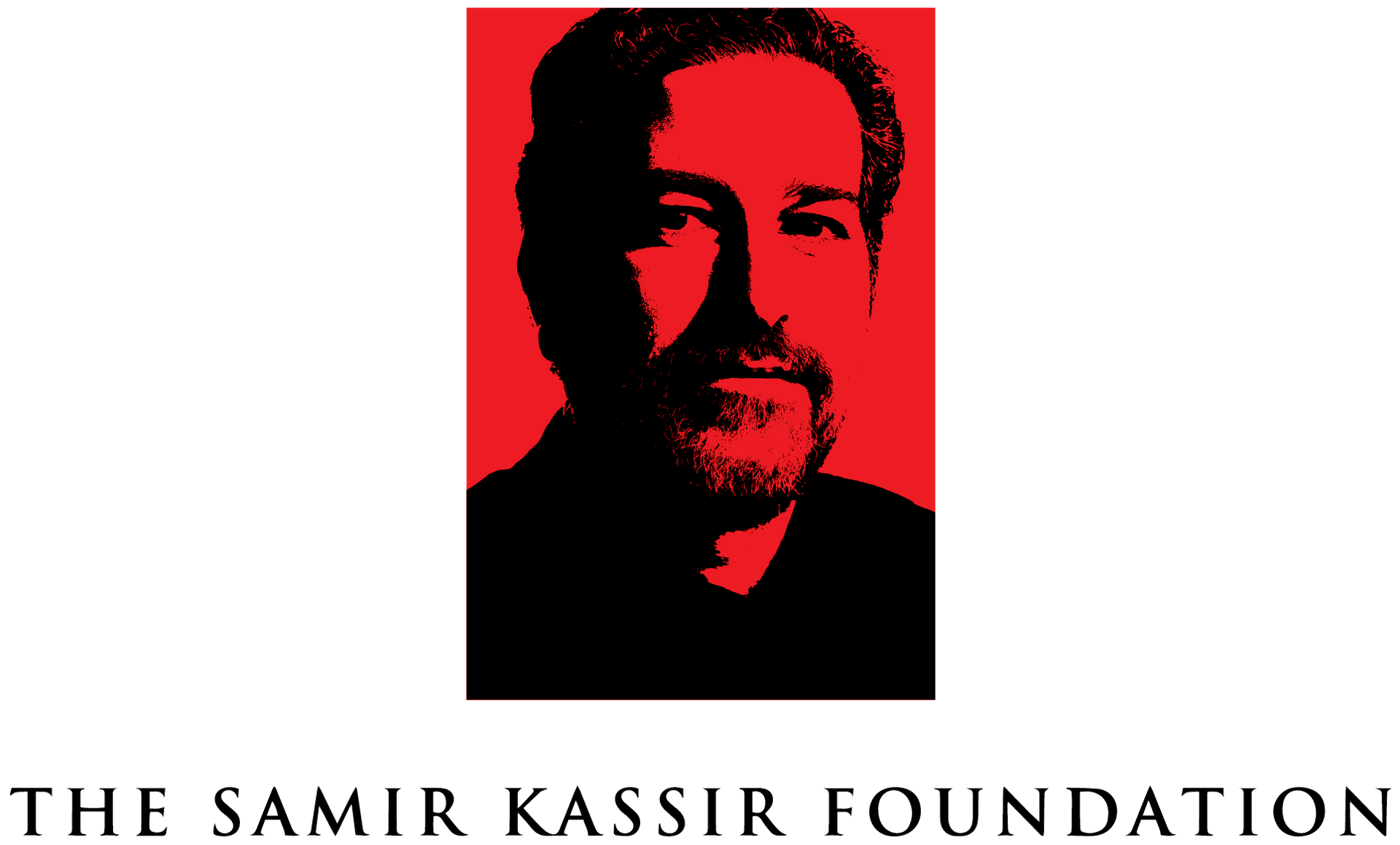TRIBUTE
FOR THE LOVE OF BEIRUT
Lebanon, United Kingdom, France, Syria, Romania, United States of America, Switzerland, Tunisia / Creation 2020
Tuesday 25 August & 1 September 2020, 9:00 pm
Facebook Live

Le mot de Wajdi Mouawad à l’ouverture de la deuxième partie du Festival du printemps de Beyrouth 2020
Je m’appelle Wajdi, Wajdi Mouawad, et je vis à Paris.
J’ai été au festival en 2013 pour présenter un spectacle, enfin, plusieurs spectacles. Il y en avait un que je jouais moi-même et il y avait un spectacle qui s’appelait « Incendies » qui avait la particularité d’avoir été créé avec des comédiens québécois lorsque j’habitais au Québec. Et donc ce sont ces comédiens québécois, donc des gens qui n’avaient jamais vraiment vécu la guerre sur leur territoire, qui sont venus raconter cette histoire aux Libanais qui se voyaient tout à coup dans la situation tout à fait étrange, de voir des Canadiens venir leur raconter leur histoire, et c’était un moment d’une puissance très, très, très grande qui m’a fait comprendre à nouveau ce que pouvait signifier écrire dans son pays, chose que je ne connais pas. Je vais continuer donc en lisant le texte que j’ai écrit pour ce soir, puisqu’il va peut-être expliquer au fond, dire, aujourd’hui, comment je me sens.
À l’invitation de la Fondation Samir Kassir pour l’évènement de ce soir, j’ai dit oui sans réfléchir.
Parce que au fond, tout ce qui peut être fait pour que nous continuions à échanger entre nous, entre Libanais, doit être fait. Tout ce qui peut contribuer à nous permettre d’être ensemble est bienvenu.
Non pas seulement parce qu’être ensemble est une chose positive, mais parce que depuis très longtemps, au Liban, être ensemble, bien plus que de tuer son père, ou son frère, plus que violer sa sœur, plus même que de coucher avec sa mère, ou pire encore, être pédé, ou avoir une dépression, être ensemble est le plus grand tabou du peuple libanais. Être ensemble c’est notre tabou. C’est la chose interdite. Et maintenant que la nouvelle génération, cette jeunesse, qui, en ce moment dans les rues tente d’être à nouveau ensemble, entraînant avec elle ce qu’il y a de plus merveilleux et de plus généreux dans ce pays, voilà qu’elle doit faire face, à nouveau, aux enfoirés d’hier qui feront tout pour empêcher que cet « être ensemble » advienne. C’est un cauchemar. Un cauchemar sans nom. Et pour renverser le cauchemar il nous faut encourager cette jeunesse car, au fond, c’est elle qui incarne aujourd’hui le désir de vivre, l’envie de liberté dans la vie. « Ndall maa baadna » (نضلّ مع بعضنا).
Voilà donc pourquoi je n’ai pas hésité à accepter cette invitation avec amitié, avec amour et puis avec le désir de participer, tout simplement, mais aussi avec un immense sentiment de culpabilité. C’est de ne pas pouvoir vous parler en arabe parce que je ne sais plus parler l’arabe. Et j’ai eu beau tourner la question dans tous les sens, j’ai beau chercher quelque chose, ce soir, à dire d’intelligent… Le fait que ce que j’allais dire, intelligent ou non, j’allais devoir le dire de toute façon dans cette langue étrangère que mon propre grand-père aurait été bien incapable d’en comprendre le moindre mot. Tout ça me donnait un sentiment, au fond, de décalage.
L’exil donc, n’est pas seulement géographique, il est surtout dans la gorge lorsque l’on ne sent plus gratter dans le gosier la douceur du « H » (ح), la puissance du « Kh »(خ), le vertige du « Aain »(ع) et l’enfance du « Ghayn »(غ). Comment dire alors la colère dans une langue qui ne soit pas la langue maternelle ?! Et quand à Montréal, à Paris, ou à Berlin, à Abidjan, ou Sao Paolo, des gens pleins de curiosité, me demandent avec attention mon nom et de quel pays je viens, je réponds, leur devant la vérité, que je suis une ordure et je viens du pays des ordures, pays fatigué par les maux, épuisé à force d’épuisement, épuisé à force de joie forcée, de sourires figés, un pays sans plus de peau que la mer qui ne le console plus, ni le soleil, ni le bleu du ciel, un pays sans plus de bras ni de jambes qui n’est plus qu’un grand cœur empoisonné dont les battements font entendre, à travers la couche de béton, une colère qui ne connaît plus aucun alphabet. « Y a-t-il encore de l’espoir ? » me demandent des vieux sorciers Comanches, qui en connaissent pourtant tout un rayon en matière de disparition et de chagrin, et je réponds toujours que l’espoir est bien sûr dans le ventre des femmes enceintes de mon pays car dans ce pas tremblant, dans ce pays tremblant, on continue à faire l’amour tous les soirs. Ce soir, on fera l’amour. Peut-être pas encore suffisamment hors mariage, pas encore suffisamment hors religion mais, de plus en plus de Roméo et Juliette s’aimant au-delà des divisions de leur famille, des noms de leur famille, des sidérations, des hymens recousus, des visages remontés et du kitch bling-bling de cette bourgeoisie qui croit encore qu’il suffit de « bien péter » en français, et de « bien roter » en anglais, pour oublier le sang arabe qui court dans ses veines. Le plus difficile n’est donc pas d’aller consulter un psychanalyste. Le plus difficile consiste à accepter de changer. Changer exige une force aussi sidérale que celle nécessaire pour faire décoller une fusée s’arrachant à l’attraction terrestre. Acceptera-t-il de s’allonger sur le divan du psychanalyste, celui-là qui dit porter le destin du pays? Acceptera-t-il de changer? Et quelle force faut-il encore pour que ce monde-là change? Car voilà, pendant que nous sommes ensemble, ils sont encore là les administrateurs anciennement sanguinaires de ce pays. Ils sont là et ils n’ont plus honte d’être là. Ils ont enfreint toutes les lois, les lois millénaires que les Dieux avaient pour prodiguer aux humains. Ils ont piétiné la loi séculaire de l’hospitalité, et ils sont toujours là dans leurs voitures et leurs palais, ensanglantés, eux-mêmes qui nous ont ensanglantés ; chefs de partis, chefs de milices, chefs de haram, chefs des bêtes sombres d’une histoire sombre qui sombre, toujours, plus sombre qu’une plaque d’obscurité, des nuits sans lune ni étoile, des enfants d’Ivor, des ogres sans testicules. Ordures, eux-mêmes noyés dans la puanteur de leur silence, ils crachent le mot « pays » comme ils crachent les injures et tous les jours ils disent « Liban » comme ils disent « Kess Emak » (كس إمّك), tous là synonymes et lapsus.
Ce n’est pas une parole de désespoir que je tiens là, et encore moins une reddition, mais bien au contraire, parce que je crois, dur comme fer, comme Kafka, qu’il y a quelque chose d’absolument indestructible en chacun de nous. Ce soir, à cause de cette indestructibilité, je n’ai pas envie de poésie, je n’ai pas envie de raviver l’espoir, je n’ai pas envie de vous raconter des histoires, je n’ai pas envie de m’émouvoir, je n’ai pas envie de dire « Liban », je n’ai pas envie de dire « Feyrouz », ni « jeunesse », je n’ai pas envie de dire ce qu’il y a de plus beau, je n’ai pas envie ce soir de pleurer les morts ni les blessés, ni les disparus, ni ma mère morte, ni mon père mort, tous deux sous la neige canadienne en ce moment, dans un cimetière quelconque, eux qui sont nés pas loin des pinèdes du Chouf. Je n’ai pas envie de dire « Beyrouth enterrée mille fois et relevée mille fois », ni envie d’évoquer la grandeur de l’art, ni le théâtre, ni la fierté, ni le bla-bla, ni le nia-nia, ni le hommos, ni le tabbouleh et ni le baba ghanouj. Rien, c’est-à-dire R I E N.
Dans son livre des Métamorphoses, Ovid raconte comment au milieu de Troie, saccagée et détruite, les Grecs avait fait avancer Hécube dans sa ville pour qu’elle puisse contempler le saccage de sa cité. Et c’est alors qu’au milieu des cadavres des soldats Troyens, Hécube aperçut son dernier enfant, sa fille Polyxène, égorgée comme victime expiatoire sur la tombe d’Achille. Alors Hécube reste muette de douleur. Elle lève d’abord la tête vers le ciel et puis, se tournant vers ses ennemis elle ouvre sa bouche toute grande pour parler, mais d’où sortent, en dépit de ses efforts, que des aboiements. Et pendant longtemps encore, on montre le rocher où elle se tenait aboyant contre tous ceux qui tentaient de l’approcher sans plus de langue, sans plus de mots, elle était devenue chienne de sa propre douleur.
Ce soir, l’envie de me tourner à mon tour vers nos ennemis, qui sont pourtant de notre sang, et l’envie de donner la parole à ce qui n’a plus de parole en moi. A ce qui n’a plus d’alphabet, qui n’a plus rien d’articulé, sauf cet aboiement qui vient, lorsque trop de violence finit par jeter le langage dans le labyrinthe des colères et des incendies.
Wajdi Mouawad
Auteur et metteur en scène
Directeur de La Colline – Théâtre National, Paris
N.B. Pendant la lecture en direct, Wajdi Mouawad a fait suivre ce texte d’une vidéo où il aboie pendant très longtemps.
The Beirut Spring Festival is a free of charge annual arts and culture programming that celebrates freedom and renewal in Beirut, in memory of Samir Kassir.

All Rights Reserved, Beirut Spring Festival.